
Au Nigéria, Rifkatu a été enlevée et violée par des extrémistes islamistes, avant d’être relâchée. Traumatisée et rejetée, elle réapprend à aimer, grâce à un accompagnement patient et à sa foi.
Avertissement: Le témoignage de Rifkatu contient des récits de violences sexuelles qui peuvent être difficiles à lire.
Quatre semaines jour pour jour après son mariage, Rifkatu (pseudonyme) a été enlevée par des extrémistes islamistes. Durant ce premier mois de mariage, elle et son mari, le pasteur Zamai (pseudonyme), s’étaient pris à rêver d’une autre vie. Après avoir été chassés de leurs maisons et de leurs champs par des extrémistes peuls, ils souhaitaient reconstruire une vie heureuse malgré l’exil forcé.
Mais ces rêves sont réduits en cendres le jour où la famille décide de prendre le risque de retourner aux champs pour récolter un peu de nourriture, devenue rare. Après avoir rassemblé de quoi manger, Zamai reconduit sur sa moto son père âgé et sa jeune sœur vers leur nouveau logis. Rifkatu et à sa belle-sœur, elles, restent dans l’ancienne ferme pour attendre pour un second trajet.

Un vrombissement de moto se rapproche. Les deux femmes sortent, croyant au retour de Zamai mais ce n’est pas lui. «Ce sont des extrémistes peuls, reconnaît la belle-sœur. Courons!»
Les deux sœurs s’enfoncent dans la brousse mais les motos les poursuivent. Les militants leur ordonnent de s’arrêter sans quoi ils leur tireront dessus. Les femmes s’immobilisent sous les moqueries de leurs assaillants et sont forcées de monter sur les motos. En s’asseyant, Rifkatu pleure. «Je suis mariée», dit-elle au conducteur. «Si ton mari était fort, il t’aurait arrachée à nos mains», rétorque l’homme.
Les sévices dans la maison abandonnée
Les jeunes femmes sont transportées jusqu’à une maison abandonnée où elles sont séparées. Durant la nuit, plusieurs hommes se succèdent pour les agresser sexuellement. Le lendemain, elles sont amenées au camp des ravisseurs, où d’autres chrétiens sont détenus. «Ils nous ont fait ça parce que nous sommes chrétiennes, affirme Rifkatu. Je n’ai pas vu de femmes musulmanes détenues.»
Dans ce camp, le calvaire continue; Rifkatu et sa belle-sœur sont violées à de multiples reprises. Par désespoir, Rifkatu ment et déclare être enceinte pour dissuader ses agresseurs, mais les hommes continuent et l’horreur se prolonge.
Au cœur de cette violence, Rifkatu prie en silence. «Arrête de prier, l’avertit une vieille femme du camp. S’ils te surprennent, ce sera pire.» Mais Rifkatu persévère intérieurement:
«Tu es le Dieu qui a sauvé Shadrak et Méshak; si tu es le même Dieu, je rentrerai chez moi.»
Le lendemain, Rifkatu sent de fortes douleurs au ventre, conséquence des sévices. Elle saigne. Parce qu’elle a dit être enceinte, les ravisseurs pensent qu’elle fait une fausse couche. Dans certaines régions, des croyances populaires mêlées à l’islam considèrent le sang menstruel comme porteur de malchance, et donc susceptible d’exposer le camp à ses ennemis.
Anahu est responsable d’un programme de soins post-traumatiques au Nigéria. Son rôle: s’assurer que les chrétiens persécutés...
Au matin, le responsable du camp vient en personne voir Rifkatu. Il s’excuse pour les violences sexuelles subies et promet de la ramener chez elle sans demander rançon car, explique-t-il, il est impossible d’obtenir quoi que ce soit si elle a fait une fausse couche. Il conduit donc Rifkatu et sa belle-sœur jusqu’à une église d’un village voisin; de là, elles retrouvent le chemin de la maison.
Après l’enfer, la peur
Au début, la communauté accueille et entoure Rifkatu. «Le jour de son retour, mon cœur débordait de joie», confie Zamai. Mais rapidement, le traumatisme fait surface. Rifkatu a peur des hommes, même de son mari. «Je ne voulais pas qu’un homme m’approche; même s’il me parlait, j’avais peur», explique-t-elle. Zamai se montre doux et patient. Il persévère, et sa femme se réhabitue peu à peu à lui. Deux mois plus tard, elle tombe enceinte.

L’ostracisme et la rumeur
Après la naissance de leur fille, la distance s’installe entre la petite famille et la communauté autour d’elle. À la suite de complications à l’accouchement, le bébé présente un retard dans son développement faisant naître des rumeurs que l’enfant serait de «paternité peule».
«Les gens ont commencé à dire que notre fille appartenait aux militants; qu’elle n’était pas un vrai bébé, raconte Zamai. Tout le monde sait que quand des femmes sont enlevées, elles sont presque toujours violées.» Autour de la jeune maman, on murmure que la fille ne ressemble pas à ses parents, mais à une «petite Peule».
L’exclusion devient douloureuse. «Même des femmes de l’église n’entraient plus chez moi, dit Rifkatu. Elles craignaient que si ma fille les voyait, elles aient aussi un enfant comme elle. Personne ne voulait s’approcher, même pas la famille.» Pour éviter les regards, Rifkatu laisse sa fille chez sa belle-mère avant de se rendre aux réunions de femmes. Mais les questions persistent: «C’est ta fille? Qu’est-ce qu’elle a? Elle ne te ressemble pas.»
Ce schéma, trop courant au Nigéria et en Afrique Subsaharienne, montre comment la violence sexuelle sert d’arme pour briser les femmes et affaiblir l’Église en semant la honte et la division.
Chercher de l’aide: écouter, nommer la douleur
Lorsque l’exclusion empoisonne le lien mère-fille, le couple comprend qu’il faut trouver de l’aide. Des partenaires de Portes Ouvertes orientent Rifkatu vers Asebe (pseudonyme), accompagnatrice bénévole dans un centre de soins post-traumatiques. «Beaucoup arrivent avec des insomnies, la peur, la solitude; d’autres redoutent le retour des agresseurs, explique Asebe. Les victimes de viol subissent en plus la stigmatisation — parfois de la part des leurs.»

À son arrivée, Rifkatu est fermée. Elle a perdu tout espoir et doute même de l’existence de Dieu. Le silence de son mari sur la tragédie l’angoisse, et elle ne supporte même pas de regarder sa propre fille. Elle avoue à Asebe avoir déjà parlé très durement à son enfant. «Tu vois ce que je traverse? Tu ajoutes à ma douleur. Meurs et laisse-moi en paix», lui a-t-elle même lancé durant ses heures les plus sombres.
Le premier geste d’Asebe est d’être présente et d’écouter. Elle pose des questions qui aident Rifkatu à mettre des mots sur ses émotions. Elle l’encourage à dessiner ce qui symbolise sa douleur, à écrire des lamentations adressées à Dieu. Peu à peu, quelque chose se dénoue.
Le tournant du pardon
Un moment clé survient lors d’une session sur le pardon où il est question de déposer sa douleur à la croix. Chaque participante est encouragée à écrire ses peines sur un morceau de papier, avant d’aller le brûler au pied d’une croix symbolique. «On nous a dit que, lorsque les cendres montent, nos douleurs montent vers Dieu», se souvient Rifkatu.

Celle qui jurait ne jamais pouvoir pardonner décide alors de pardonner, «avec l’aide de Dieu». Elle demande la prière pour que sa douleur lui soit ôtée et souhaite de nouveau dédier sa vie à Christ. «J’ai pardonné dans mon cœur; que Dieu les aide à se repentir», dit-elle des militants.
Restaurer ce qui a été brisé
Le changement chez Rifkatu décide Zamai à suivre, lui aussi, un parcours de guérison. Comme beaucoup de maris de survivantes, il portait en lui la honte et une colère meurtrière, nourrie par une soif de vengeance. La formation le ramène au pardon. «Sans cette guérison, peut-être que notre relation ne serait toujours pas réparée», reconnaît-il. Il apprend à embrasser la situation avec foi: «Notre Dieu Tout-Puissant sait tout.»

Le lien entre Rifkatu et sa fille se transforme également. Avant, l’enfant n’était qu’un rappel douloureux du viol et du rejet. «Rifkatu pouvait passer des semaines sans la prendre», rapporte Asebe. Après les sessions, Rifkatu enlace sa fille, aime être avec elle, retrouve de la joie. Les blessures ne disparaissent pas d’un coup — «parfois, Rifkatu ressent encore la douleur», note Asebe. Mais son état d’esprit a changé: elle avance vers la vie, vers une relation restaurée «telle que Dieu la veut».
«Que nos voix soient entendues»
Le chemin de Rifkatu n’est pas terminé. Elle et Zamai ont besoin d’un soutien durable pour reconstruire leur vie, leur famille et leur avenir. En Afrique Subsaharienne, les femmes comme Rifkatu sont nombreuses à avoir besoin d’un accompagnement spécialisé pour entamer la guérison.
«Nous voulons que les voix de ces femmes soient entendues, plaide Asebe. Que le monde sache ce qui arrive aux femmes chrétiennes au Nigéria. Leurs droits ne sont pas protégés. Elles sont traumatisées, abusées à cause de leur foi. Nous voulons que cela cesse.» L’accompagnatrice nous appelle à parler, à agir, et à soutenir concrètement celles qui souffrent: «Ce que les humains ne peuvent pas faire, Dieu peut l’accomplir.»

Comment Agir?
Face à la violence envers les chrétiens en Afrique Subsaharienne, Portes Ouvertes a lancé la campagne «Afrique: Unis contre la violence». Vous pouvez vous joindre à cette campagne pour soutenir nos frères et sœurs qui subissent de plein fouet cette persécution.
- PRIEZ pour Rifkatu avec les sujets de prière ci-dessous. En vous abonnant au Fil Rouge, recevez un sujet de prière par email chaque semaine.
- DONNEZ pour soutenir les projets comme ce centre d'accompagnement post-traumatique au Nigéria.
- SIGNEZ la pétition pour demander la protection, la justice et la restauration pour les chrétiens victimes de violence en Afrique Subsaharienne. Si vous avez déjà signé, vous pouvez partager la pétition autour de vous.
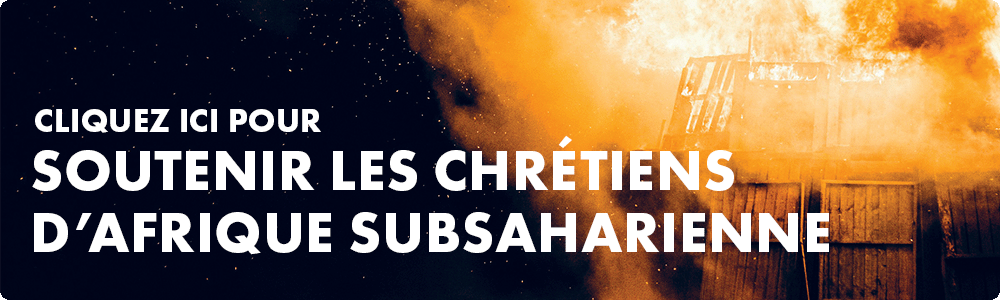
Sujets de prière
- Prions pour la guérison émotionnelle, spirituelle et physique de Rifkatu.
- Remercions Dieu pour les centres de soins post-traumatiques où des milliers de chrétiens persécutés trouvent la guérison chaque année.
- Prions pour les 1700 femmes blessées comme Rifkatu; que Dieu suscite des personnes pour les accompagner sur le chemin de la guérison.
